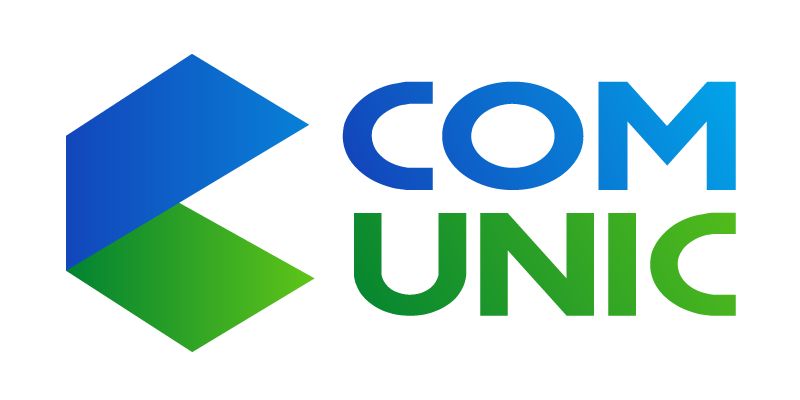Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 a redéfini le périmètre de la tentative de résolution amiable obligatoire, modifiant directement les obligations procédurales des entreprises concernées par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Certaines actions en justice demeurent pourtant exclues de cette démarche, créant des disparités notables dans la gestion des litiges.La méconnaissance de ces nouvelles exigences expose à des fins de non-recevoir systématiques. La marge d’interprétation laissée par le législateur continue d’alimenter l’insécurité juridique autour de l’application concrète de cette règle dans l’environnement professionnel.
Comprendre l’article 750-1 du Code de procédure civile : origine, objectifs et portée en entreprise
L’article 750-1 du code de procédure civile s’impose comme un tournant dans la justice civile : dorénavant, la tentative de résolution amiable devient un acte presque réflexe avant d’envisager le judiciaire. Après la loi de programmation 2018-2022 puis la réforme par le décret n° 2023-357, impossible pour une entreprise d’ignorer ce filtre initial pour saisir le tribunal judiciaire dans un litige civil.
L’objectif sonne limpide : désengorger les salles d’audience, pousser à la négociation et raccourcir les délais de résolution. La procédure civile change donc d’allure : avant de solliciter un magistrat, chaque partie doit jouer la carte du dialogue. Pour tout acteur d’entreprise, cela devient un automatisme à intégrer au traitement des litiges faute de quoi la demande en justice risque d’être recalée sans ménagement.
Ce texte couvre tous les litiges civils de droit commun mais ne laisse pas la place à la rigidité absolue. Quelques exceptions sont prévues : pour les demandes au-delà de 5 000 euros, en cas d’urgence légitime ou d’impossibilité réelle à engager un échange amiable. Le législateur conserve un filet de sécurité pour ménager le recours direct au juge là où l’amiable s’avère inadapté. Malgré tout, la pression se porte sur la généralisation des modes amiables de résolution.
Désormais, les juristes d’entreprise, les responsables conformité et les avocats réécrivent leurs routines. Systématiser la preuve de la tentative amiable, étoffer la préparation des dossiers : tel est le nouveau standard. Fini le temps de l’à-peu-près, la moindre faille dans la démarche se paie cash devant le tribunal judiciaire.
Quels changements concrets avec le décret n° 2023-357 ?
Le décret n° 2023-357 renforce le tour de vis autour de l’article 750-1 du code de procédure civile : la tentative amiable préalable ne se contente plus d’être déclarée, elle doit être réelle, circonstanciée et prouvée dès la saisine du tribunal judiciaire. En résumé : une lettre ou une simple mention ne font plus illusion.
L’exigence de l’obligation se précise : impossible de rectifier le tir une fois la procédure enclenchée. Le juge peut donc refuser la demande si la pièce justificative n’apparaît pas immédiatement au dossier. Médiation, conciliation, procédure participative : toutes sont désormais au cœur du processus, sauf dans quelques circonstances dûment encadrées.
Pour mieux saisir quand la tentative amiable n’est pas exigée, il faut distinguer les cas particuliers :
- Urgence justifiée et réelle
- Manque de disponibilités chez les conciliateurs de justice
- Difficulté manifeste à initier une démarche amiable
Désormais, la preuve écrite ne se discute pas : il faut fournir une attestation, un procès-verbal de non-conciliation ou la trace officielle d’un refus de médiation. Ce resserrement, voulu par le décret, impose une gestion encore plus organisée des contentieux. Exit les oublis ou démarches approximatives : chaque partie doit anticiper, constituer et conserver ces preuves. L’objectif reste le même : limiter la mauvaise foi et imposer des pratiques harmonisées sur tout le territoire.
La tentative amiable obligatoire : modalités pratiques et enjeux pour les entreprises
Désormais, difficile d’imaginer une action devant le tribunal judiciaire sans avoir tenté une solution amiable. Pour les entreprises, cette étape conditionne directement la suite du dossier. Il s’agit de lancer une conciliation, d’avoir recours à la médiation ou de mettre en place une procédure participative, et tout doit s’inscrire noir sur blanc. Un simple échange de mails ne pèse pas lourd : il convient d’apporter un procès-verbal de non-conciliation ou bien une attestation délivrée par un conciliateur de justice.
Pour répondre à cette nouvelle donne, il est nécessaire d’adopter de nouveaux réflexes juridiques. Repérer les catégories de litiges concernés, choisir la méthode adéquate (médiation, conciliation, procédure participative), anticiper les délais, prévoir les coûts liés aux frais de procédure ou à l’accompagnement : tout se planifie. Ce recours préalable s’est imposé, et le moindre manquement ferme la porte au tribunal.
Il ne s’agit plus seulement de désigner un médiateur ou un conciliateur. Chaque étape devient stratégique : organiser le premier rendez-vous, envoyer une mise en demeure, constituer une archive claire des échanges. Certaines assurances protection juridique intègrent la prise en charge de ces démarches, et il vaut toujours mieux consulter le contenu des contrats signés. Quant aux exceptions sur l’inaccessibilité des conciliateurs ou l’urgence, elles sont passées au crible par le juge, qui exige des pièces irréprochables. Garder trace de chaque action reste le meilleur rempart contre la nullité de la saisine.
Vers une gestion apaisée des litiges : ressources et pistes complémentaires sur la médiation
La médiation tire son épingle du jeu grâce à sa souplesse et sa capacité à restaurer le dialogue, là où la procédure bloque souvent toute communication. Pour l’entreprise, c’est une voie qui rompt le face-à-face, fait émerger d’autres scénarios, et dénoue les crispations. Le processus de règlement amiable ne se résume pas à une étape imposée, il s’ajuste à chaque situation : différends commerciaux, gouvernance ou contrat de prestation, tout y passe. L’intervention d’un tiers impartial relance la conversation et renouvelle les possibles.
Sur le terrain, la dynamique s’oriente clairement vers l’encouragement des modes amiables. Les directives européennes de ces quinze dernières années poussent en ce sens, et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille attentivement à l’alignement des pratiques. Les cours d’appel, elles, s’engagent de plus en plus concrètement : listes de médiateurs agréés, formation des magistrats, dispositifs numériques… la diffusion de la culture de la médiation est enclenchée.
Pour bâtir une politique interne structurée, les entreprises disposent désormais de points d’appui :
- Répertoires régionaux de médiateurs consultables via les organismes rattachés aux cours d’appel
- Dispositifs sectoriels dans la banque, l’assurance ou la consommation pour des litiges spécifiques
- Solutions locales proposées par les tribunaux ou établissements publics compétents
S’appuyer sur ces ressources, former les équipes juridiques, avancer avec méthode et savoir quand solliciter une expertise extérieure : voilà les clés d’une gestion apaisée et professionnelle du contentieux. L’écriture des litiges ne se joue décidément plus uniquement sous la robe du magistrat, elle se réinvente aussi dans les espaces de dialogue où chacun retrouve voix au chapitre.